|
Nouveaux besoins ? Politique d'expansion ? Conquêtes territoriales ? Échanges commerciaux ? L'évolution de la société égyptienne a conduit les pharaons conquérants à établir, étape par étape, un formidable système défensif, d'Éléphantine à la 3ème cataracte, incluant à chaque fois un vaste programme architectural. La constante agressivité des peuples du pays de Koush contraignit essentiellement Sésostris III à édifier de véritables petites villes fortifiées. On dénombre ainsi sept forteresses en Basse Nubie, essentiellement concentrées au niveau de la 2ème cataracte, et dix en Haute Nubie que je vous propose de découvrir au passage de votre souris. |
SERRA OUEST
Le site, situé à quelques kilomètres du village Aksha abritait un temple dédié à l'image déifiée de Ramsès II. La base d'un des pylônes ainsi que quelques inscriptions sont aujourd'hui exposées au musée de Khartoum.
Avant l'immersion définitive du site, les fouilles entreprises par la misson franco-argentique entre 1961 et 1963 ont mis à jour une ville fortifiée datant de Sethy Ier, une nécropole méroïtique ainsi qu'un cimetière du groupe C.
Cette forteresse eut un rôle important dans l'histoire nubienne. Elle était vraisemblablement le siège des Nubiens fournissant à l'Egypte ses corps de police composés des célèbres archers.
KAWA
Située sur la hauteur de l'actuelle Dongola, au point de départ de la "route de Meheila", l'antique citadelle a été fondée par Amenhotep III. Son temple dédié à Amon fut embelli par Taharqa, pharaon koushite de la XXVème D. Enseveli à moitié sous les sables, il a révélé lors des fouilles de 1920 plusieurs stèles méroïtiques.

SESEBI
Située au niveau de la 3ème cataracte, cette colonie fondée par Thoutmosis III était composée d'une colossale enceinte rectangulaire percée de quatre portes, d'une zone d'habitation, d'un temple dédié à Amon, puis à Aton lors de la période amarnienne (dont on peut encore voir 3 colonnes) et d' entrepôts encore visibles.

ILE DE SAÏ
Sesostris III comprit l'importance du rôle stratégique de l'île (l'antique Shaat) située entre la 2ème et 3ème cataracte, et y établit un important centre d'affaires, noyau des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Koush.
Les fouilles ont mis à jour des tombes appartenant aux cultures du groupe A et du Kerma, des colonnes et des stèles datant du Moyen et Nouvel Empire. Les vestiges de la citadelle, construite par les armées turques d'Ismaïl Pacha en 1820 lors de sa conquête du Soudan, dominent encore l'île.
KOR
Selon l'archéologue Jean Vercoutter, ce site situé au niveau de la 2ème cataracte, correspondrait à la partie commerciale de la forteresse de Mirgissa (ou Iken), aujourd'hui sous les eaux.
Avant leur immersion, les ruines ont révélé de grandes maisons, appartenant sans doute à de hauts fonctionnaires et une enceinte aux murs peu épais.
FARAS
Cette citadelle fut également ordonnée par Sésostris III. Les fouilles ont mis à jour :
- les fondations d'un temple d'Aménophis III,
- les vestiges d'une basilique chrétienne : Faras était, de par sa proximité avec Qasr Ibrîm, devenu un centre religieux très actif lors la christianisation de la Nubie au VIIIè s.)
- des peintures médiévales de style byzantin et copte
- des documents gravés d'époque méroïtique, grecque et byzantine.
Le Musée National soudanais s'est ainsi doté d'une collection unique de peintures religieuses médiévales.
SOLEB
Le pays du Wawat étant enfin dominé, les tributs d'or pouvaient arriver en abondance en Égypte. Amenophis III choisit le site de Soleb pour ériger en prestige son temple jubilaire.
Ce monument qui "rivalise de splendeur et d'élégance avec celui de Louxor" (pour reprendre les termes de C. Desroches Noblecourt) est aujourd'hui le monument égyptien le mieux conservé en Nubie et présente le shéma classique : pylône, cour et salle hypostyle.
ÉLÉPHANTINE

Dès le Moyen empire, le souverain Monthouhotep II fit ériger sur l'île un fort afin de pénétrer au-delà de la 1ère cataracte pour contrôler les caravanes marchandes. Ceinte de murailles, elle deviendra le point de départ de nombreuses expéditions.
TOMBOS
Thoutmosis Ier y érigea une citadelle, marquant ainsi la frontière égyptienne au niveau de la 3ème cataracte. L'édifice a aujourd'hui entièrement disparu mais il reste plusieurs stèles :
- "La Grande Stèle de Tombos" retraçant la défaite des gens du Koush et la puissance de Thoutmosis Ier.
- Des stèles de Thoutmosis III, continuant les campagnes militaires entamées par Thoutmosis Ier.
- Des documents gravés par Inéni, architecte royal de Thoutmosis Ier.
Sur le site, gît un colosse inachevé d'un pharaon de la XXVè Dynastie : Taharqa ou Tanoutamon.
seMNa
Oeuvre de Sésostris III, ce site recèle trois forteresses : Semna Ouest (la plus imposante et de forme en L), Semna Est et Semna Sud (ou Kouma).
Il érigea deux stèles identiques en l'an 16 de son règne (une à Ouronarti, l'autre à Semna) et l'on peut y lire aussi :
"Puisque se taire, après une attaque, c'est enhardir le cœur de l'ennemi, alors c'est du courage que d'être agressif, et de la lâcheté que de faire retraite".
SHELFAK
Située au niveau de la 2ème cataracte, la forteresse fut érigée par Sésostris III. Hormis le fait qu'elle présentait le schéma classique architectural, les murs en brique crue avaient été recouverts d'un enduit blanc.
L'ensemble militaire gît aujourd'hui sous les eaux du Lac Nasser. Seul le temple a été démonté et rebâti au Musée Archéologique de Khartoum.
OURONARTI
Sésostris III, toujours dans son programme de contrôler le Koush, ordonna la construction d'une forteresse sur l'île d'Ouronarti. Le plan de l'ensemble militaire couvre entièrement celle-ci. En l'an 16 de son règne, il fit graver un stèle sur laquelle on peut lire :
"Ainsi tout fils de moi qui maintiendra cette frontière établie par ma Majesté, c'est mon fils et il a été engendré par ma Majesté".
QOUBAN
Située au Nord de la Nubie, érigée par Sésostris Ier puis consolidée par Sésostris III, elle contrôlait à la fois le trafic du désert et celui du fleuve.
Aux murs de briques très épais, elle abritait garnisons et bureaux administratifs et constituait la base de toutes expéditions vers le pays de l'or, contrôlant départ et retour des caravanes chargées de ramener le métal si précieux.
Faisant face à Semna, cette forteresse abritait un temple édifié en l'honneur de Khnoum "Seigneur des Cataractes" par Thoutmosis Ier et agrandi par Amenophis II. Les principales scènes mettent en valeur Khnoum, Dedoun (dieu protecteur du Koush) et Sésostris III (ici déifié).
Le petit temple carré fut démonté et reconstruit dans les jardins du Musée Archéologique de Khartoum avant l'immersion totale du site.
QASR IBRIM
Située sur un piton rocheux, la citadelle domine le Lac Nasser. Des fouilles continuent encore aujourd'hui sur le site et ont déjà mis à jour les temples du pharaon de la XXVè D., Taharqa, des traces de cultures de Napata et de Méroé ainsi que des murailles d'époque romaine.
Monthouhotep II, Thoutmosis Ier, Hatchepsout et bien d'autres pharaons ont également laissé leur empreinte.
La cathédrale chrétienne témoigne d'un centre religieux actif sous le règne des Nobades. Depuis 1812, date à laquelle les Mamelouks ont été expulsé par l'Égypte, le site est abandonné.
IKHOUR
Tout comme la forteresse de Kouban, elle défendait l'arrivée des caravanes fluviales ou terrestres en provenance du Wadi Allaki, riche en mines d'or.
La sécurité étant assurée, Sésostris Ier put envoyer "mille ânes et mille trois cent hommes de carriers et tailleurs de pierre en expédition" aux carrières.
Aujourd'hui, la forteresse est ennoyée par les eaux de la retenue du Lac Nasser.
ANIBA
Aniba ou l'ancienne Miam était la capitale de Basse Nubie. Le Koush insoumis contraignit Sésostris Ier à ériger de petites villes fortifiées telles Bouhen et Aniba qui furent consolidées sous Sésostris III. Avant l'immersion du site, on pouvait y voir un fort et les vestiges de la ville. Les fouilles permirent également de mettre à jour (provisoirement) deux types d'habitation nubienne de forme circulaire ainsi que des tombes pyramidales à voûte datant du Moyen empire. Le tombeau de Pennout Ier a ainsi pu être sauvé des eaux et reconstruit à 40 Km au Nord-Est du site aujourd'hui englouti.
MIRGISSA
Construite sur la 2ème cataracte par Sésostris III (XIIè D.) cette citadelle, de plan rectangulaire, présentait le schéma classique : murs fortifiés, un fossé et deux enceintes.
Sous la direction de J. VERCOUTTER, la Mission Archéologique Française au Soudan découvrit lors de l'étude du site (entre 1962 et 1969), un dépôt d'armes, des grenier, un temple de Sésostris III, une villa dans la ville ouverte.
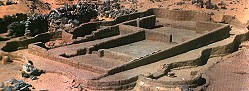
La forteresse gît aujourd'hui sous les eaux du Lac Nasser.
BOUHEN
Fondée à l'époque thinite, elle est la plus ancienne colonie égyptienne basée sur la 2ème cataracte. Sous l'Ancien Empire, elle devint un centre actif de travail du cuivre, fut remplacée par un établissement destiné à traiter les pierres telles la dioryte, extraites dans les carrières du désert nubien.
Sésostris Ier y érigea au Moyen Empire la première forteresse de la 2ème cataracte, lors de son programme d'expansion (l'architecture présente tous les aspects de nos châteaux forts !).
Aujourd'hui, sous les eaux, seul le petit temple a été reconstitué dans le jardin du Musée de Khartoum.
| La plupart de ces fortifications ont été érigées au Moyen Empire, sous l'initiative de Sésostris Ier (XIIè D.) dans un but de surveillance du fleuve. Mais c'est Sesostris III qui acheva ce formidable système défensif : Serra est "celle qui repousse les Medjayou", Askout "celle qui repousse les Setyou, Shelfak "celle qui domine les pays étrangers", Ouronarti "celle qui repousse les Iounou", Semna Ouest "Kha-kaou-Rê est puissant", Koumma "celle qui repousse les arcs", Semna Sud "celle qui soumet les Nubiens"..... Ces villes fortifiées obéissent à un plan architectural commun : larges et profonds fossés, murs épais de 4 à 8 mètres, murailles crénelées renforcées par des bastions percés de meurtrières, glacis. Les garnisons s'organisaient à l'intérieur, les pistes vers le pays du sud étaient tracées et protégées. Et tout en inaugurant dans une architecture militaire, les pharaons n'oublièrent jamais de se placer sous la protection des forces divines en intégrant des lieux de culte. Abandonnées pendant la Deuxième Période Intermédiaire, elles furent restaurées sous le Nouvel Empire, jouant un rôle majeur dans les échanges commerciaux entretenus par les pharaons conquérants avec l'Afrique Équatoriale. Lors de la construction du premier barrage, puis du Saad-el-Ali, elles firent l'objet d'études minutieuses. Jean Vercoutter, égyptologue à la Chaire d'Egyptologie de l'Université de Lille", recensa pas moins de 300 sites soudanais qui allaient être ennoyés mais concentra ses recherches sur les sites de Mirgissa et Bouhen-Sud. Les travaux de Francis Geus (son successeur) à Saï tout comme ceux de Jean Leclant et Catherine Berger, à Sedeinga permirent de mieux comprendre le rôle de ces colonies d'époque pharaonique, mais surtout firent naître une archéologie soudanaise. L'exposition des Antiquités Soudanaises, sous la direction de Jacques Reinold (directeur de la S.F.D.A.S.) en l'an 2000 est le formidable résultat de toute une coopération internationale qui permit de présenter les travaux effectués dans l'urgence, des différentes missions.
|